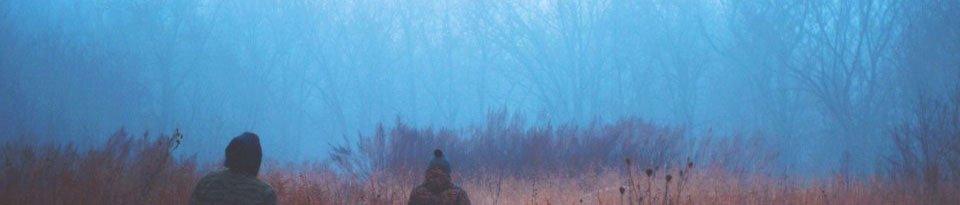Parc Paul-Mistral (http://fr.wikipedia.org/ )
Le parc Paul-Mistral est un parc urbain de 27 hectares d’un seul tenant, situé à Grenoble, renfermant plusieurs équipements sportifs majeurs, ainsi que l’hôtel de ville.
Situé sur un ancien terrain militaire du Génie, le site va prendre sa configuration actuelle grâce au déroulement de l’exposition internationale de la houille blanche de 1925.
Historique
À partir de 1836, suite à la construction des remparts de la ville par le général Haxo, la zone de l’actuel parc Paul-Mistral est utilisée comme polygone du Génie extra-muros pour l’entraînement au tir. Elle est même à l’intérieur de la zone de servitude militaire la plus stricte, là où aucune construction n’est autorisée par les militaires. À cet endroit, se trouve l’une des cinq portes d’accès de la ville, la porte des Alpes, qui permet de partir vers Eybens ou Vizille.
L’exposition de 1925
En 1919, un maire ambitieux, Paul Mistral souhaite ouvrir la ville en détruisant les remparts Haxo. Profitant d’une certaine expansion économique générée par l’utilisation de la houille blanche, il en profite pour annoncer dès 1921 son souhait d’organiser à Grenoble une exposition internationale ayant pour thème la houille blanche et le tourisme. L’opération consistant au déclassement de Grenoble comme place forte est nécessaire pour abattre les remparts, et se déroule en 1921. Mais une telle exposition nécessite aussi un vaste terrain proche du cœur de la ville et implique la démolition de l’enceinte Haxo ainsi que de son prolongement en direction du Drac achevé en 1879.
Avec la démolition des remparts, le polygone du Génie peut être utilisé, le nouveau boulevard des Alpes est créé au nord, à la place des remparts, et l’avenue d’Eybens voit son extrémité nord redressée afin de longer à l’ouest le site de l’exposition. Au sud du polygone, le chemin de ronde devient le boulevard Clemenceau, et à l’est la rue Malakoff est prolongée. Un nouveau plan d’urbanisme est proposé à cette occasion par l’architecte parisien Léon Jaussely, visant à remodeler l’ensemble de la ville. L’exposition internationale de la houille blanche qui se déroule du 21 mai au 25 octobre 1925 accueille 1 050 000 visiteurs dans ses différents palais et attractions, symbolisant un succès politique et financier pour le maire.
Bassins et fontaines géantes de l’exposition
Après l’exposition, le parc toujours clôturé est ouvert au public qui est toléré uniquement dans les allées, la fréquentation est strictement réglementée. En 1928, l’installation d’un manège d’enfant est refusé par la mairie. Il faudra attendre 1952 pour que des jeux d’enfants y soient installés. En juillet 1926, le hangar ayant servi de garage aux nombreuses automobiles durant l’exposition est détruit. De nombreux pavillons sont acquis par la ville le 18 octobre 1926 à un entrepreneur de Vizille, monsieur Mornand, ainsi qu’au Touring Club de France. Puis, au fil des années, ils sont détruits à l’exception de la tour d’orientation appelée tour Perret du nom de son architecte, du palais des chemins de fer et du palais de la houille blanche qui serviront tous les deux de palais des expositions jusqu’au milieu des années 1960. En 1929, la ville loue la maison moderne, une attraction de l’exposition, en vue de l’installation du poste radiophonique « Alpes-Grenoble ». La tour Perret accessible par ses deux ascenseurs reste l’attraction mais une autre vient la concurrencer, celle du jardin zoologique dans lequel deux ours vedettes, Martin et Michka, cohabitent avec des loups, daims, chevreuils et sangliers. Ces ours avaient été offerts à la ville en 1925 par l’ambassadeur de Russie. Le 8 février 1932, le conseil municipal de Paul Mistral vote la construction du premier équipement sportif du parc à la demande des sociétés cyclistes. Une « piste vélocipédique » est construite avec des gradins en bordure du boulevard Clemenceau, évitant aux adhérents d’aller s’entraîner sur l’esplanade de la porte de France.
Suite à la mort brutale du maire Paul Mistral, la séance du conseil municipal du 31 octobre 1932 présidée par son premier adjoint, Adrien Ricard, décide de renommer le parc de l’exposition en parc Paul-Mistral. C’est à cette époque que se pose le problème pour la nouvelle municipalité de Léon Martin de la construction d’un stade-vélodrome dans la ville. Le parc Paul-Mistral est ainsi choisi pour la construction d’un stade de 18 000 places dont la mise en service a lieu en 1937. Onze ans plus tard, la municipalité de Marius Bally va lui attribuer le nom de stade Charles-Berty. Ce stade servira par la suite à des arrivées de courses cyclistes, notamment pour le Critérium du Dauphiné libéré et le Tour de France. En 1936, c’est le parc Paul-Mistral qui est choisi pour accueillir l’imposant monument dédié aux diables bleus, en bordure du parc et à l’extrémité de l’avenue Jean-Perrot.
Monuments des déportés (1950)
Le 2 février 1939, le parc accueille 2 170 réfugiés espagnols qui arrivent en train poussés par la guerre civile dans leur pays. Pour l’occasion, le palais de la houille blanche est réquisitionné, ainsi que le pavillon d’Armenonville, ancien restaurant de l’exposition qui est attribué aux femmes et aux enfants au biberon. Ces réfugiés resteront jusqu’en juin avant de repartir dans le nord de l’Isère. Au cours de la seconde guerre mondiale, les animaux du jardin zoologique, faute de nourriture, doivent être sacrifiés afin d’abréger leurs souffrances durant le mois d’octobre 1943.
En 1950, un monument est érigé par le sculpteur Émile Gilioli à proximité du monument des diables bleus. Le monument fait en hommage aux 398 grenoblois déportés par les allemands lors d’une manifestation le 11 novembre 1943, représente une femme accablée, appuyant sa tête sur son bras formant ainsi une petite ouverture, tel le hublot d’un cachot, symbole de privation de liberté et de la souffrance des déportés11. Sur les côtés de l’œuvre, sont gravés des vers du poète Charles Péguy.
Parc Paul-Mistral (jardin alpin)
Vers 1953, la ville commence a rechercher des espaces pour des équipements municipaux et un projet d’architecte est préparé afin d’installer le Conservatoire municipal de musique dans un monumental bâtiment le long du boulevard Jean-Pain, dans le parc Paul-Mistral. Mais ce projet reste sans suite dans ce lieu et verra sa réalisation dans le sud de la ville. Dès 1955, la tour Perret inquiète la municipalité de Léon Martin car son béton commence à s’effriter laissant apparaître son armature métallique sur les faces extérieures. Une tentative de rénovation reste sans effet sur l’oxydation de son ossature métallique, et on commence à envisager sa fermeture au public. Dans les années 1960, le Verderet, ruisseau qui traverse la ville et le parc dans un sens sud-nord, est canalisé en souterrain sur six kilomètres. Le cheminement du ruisseau traversant le parc Paul-Mistral est lui aussi canalisé.
En 1963, la patinoire Clemenceau est construite accolée à un bowling dans le parc le long du boulevard Clemenceau, en lieu et place de la « piste vélocipédique ». Deux ans plus tard, un nouvel accès à Grenoble depuis la vallée du Grésivaudan est mis en service avec une desserte par le pont de la porte de Savoie. Le parc Paul-Mistral devient la toile de fond de l’arrivée de Grenoble.
Un site olympique
Avec la désignation de la ville en 1964 dans l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de 1968, le parc Paul-Mistral devient un site olympique dont les dernières clôtures de 1925 sont supprimées, devenant alors un parc ouvert. Dès février 1964, débute le chantier de démolition, pour sa partie supérieure, de l’immense palais de la houille blanche vieillissant. Cette première phase de démolition est achevée en avril 1965, et la seconde démarre à partir du 15 novembre 1965 pour le sous-sol du palais utilisé jusqu’au dernier moment comme entrepôt pour la ville. Sa démolition ainsi que celle des bassins et fontaines sont achevées en mars 1966. L’événement sportif entraîne dès 1966 trois énormes chantiers au sein du parc, celui d’un nouvel hôtel de ville transféré de l’Hôtel de Lesdiguières, de l’anneau de patinage de vitesse et du stade de glace construit à la place d’un ancien stade militaire des années 1920. Le stade de glace qui prendra en 1971 la dénomination de palais des sports, portera le nom de Pierre Mendès France à partir de 1983 en hommage à l’ancien député de l’Isère et Président du conseil. Avec ces chantiers, le parc a l’occasion d’être remodelé pour une nouvelle manifestation et se voit éclairci. Son aspect sauvage est atténué par l’élimination d’arbres remplacés par de vastes espaces engazonnés, découpés par de nombreuses allées courbes et dissymétriques. Un bassin avec une petite rivière sont créés dans ce qui prend le nom de jardin alpin.
Sculpture Père et fils (1967)
Simultanément, en 1966, Grenoble est choisie pour accueillir le premier symposium français de sculptureorganisé par Georges Boudaille. Le parc Paul-Mistral est l’un des principaux sites choisis par le comité directeur du symposium dès juillet 1966. La ville est retenue dans un contexte très favorable où peuvent se mettent en relation une nouvelle architecture avec un nouvel urbanisme. De plus, le préfet en place, Maurice Doublet, passionné d’art contemporain porte un grand intérêt au projet. Ce symposium permet l’embellissement de la ville par quinze sculptures contemporaines souvent monumentales préparées par les artistes durant tout l’été 1967. Inauguré le 9 septembre 1967, le symposium apporte cinq sculptures au parc, Mutants de Maxime Descombin, Père et fils de Grégor Apostu, Petit plaisir de Joseph Wiss, Pousse de marbre de Gigi Guadagnucci, et Totem de Robert Roussil, unique œuvre en bois mais qui a dû être démontée en 1971 pour des raisons de sécurité.
Mémorial de Paul Mistral (1972)
En 1972, le monument dédié à Paul Mistral érigé sous la municipalité de Léon Martin, près du boulevard Maréchal-Foch, est remodelé et déplacé à son emplacement actuel.
Les 2 et 3 octobre 1987, la vasque olympique de 1968 transférée après les jeux au parc de l’institut national des sports de Vincennes, est rapatriée jusqu’à Grenoble où elle est rénovée. Construite par la société Stefi de Valence en collaboration avec la société grenobloise Neyrpic, elle a une hauteur de 1,30 mètre, un diamètre de 4 mètres, pèse 2 500 kilos et son inauguration se déroule le 19 janvier 1988 sur un support construit pour l’occasion au bord du parc Paul-Mistral.
De l’autre côté du parc, un concert des Pink Floyd dans le stade-vélodrome Charles-Berty le 15 juillet 1988, oblige la destruction de sa piste, augurant de sa future démolition. Le 11 septembre 1991, un incendie détruit la piste démontable du stade entreposée sous les gradins.
Stèle du génocide arménien (1999)
Le 5 juin 1999, est inauguré un monument dédié au génocide arménien de 1915. La stèle, offerte par la communauté arménienne de la ville, est en pierre d’Arménie gravée de façon traditionnelle.
En 2001, alors que le bâtiment de la patinoire Clemenceau change de destination en devenant la halle Clemenceau aux multiples activités, un projet de reconstruction du stade de football lance des débats passionnés entre partisans et adversaires du projet.
La reconstruction d’un stade est contestée par 4 grands arguments: son emplacement, son orientation, son utilité, son coût. Les arguments relatifs au Parc Paul-Mistral sont l’emplacement et l’orientation. En effet, son orientation parallèle au boulevard Jean Pain, à 90° par rapport à celle de l’ancien stade Charles Berty, ainsi que le besoin de faire accéder les engins de chantier, entraînent la coupe d’environ 200 arbres, dont certains très anciens. Un autre argument soulevé fut celui de sa localisation, en plein centre ville, dans le principal poumon vert de grenoble. Enfin, le stade risquait aussi d’occasionner de sérieux embouteillages et nuisances sonores lors des soirs de match ou de concert. Il existait pourtant des grands espaces desservis par le tram à l’entrée de la ville, en particulier le site Elf à Saint Martin d´Hères situé à proximité du tram B et d´’un échangeur autoroute La rocade Sud est certes réputée pour être régulièrement encombrée, mais le centre-ville également.
La démolition du stade Charles Berty devenu vétuste, est achevée en 2003 et les derniers animaux présents dans le parc sont transférés dans le parc du château de Vizille. Le site en travaux ainsi que le choix du parc pour le tir des feux d’artifices étant peu favorable à leur maintien au sein du parc. En contrepartie, le parking automobile de 400 places à l’autre bout du parc est transformé en espace vert parsemé de plantes vivaces.
À partir de novembre 2003 des opposants occupent de manière permanente et illégale des arbres devant être abattus. Durant les mois qui vont suivre, ils seront soutenus par les dons d’une partie de la population, avant, en février 2004 d’être délogés par les forces de l’ordre.
L’Envol : l’oiseau (1967)
L’opération est aussi l’occasion pour la ville d’étendre le parc au-delà du stade des Alpes en supprimant le vaste échangeur routier des Sablons, mais obligeant les piétons à traverser l’avenue de Valmy et sa ligne de tram pour aller d’un parc à l’autre. C’est l’architecte Alexandre Chemetoff qui aménage l’extension rejoignant les bords de l’Isère, et dans laquelle se trouve une sculpture du symposium de 1967, L’Envol : l’oiseau du sculpteur Costas Coulentianos.
Le 28 janvier 2008, le conseil municipal baptise le site regroupant le monuments des diables bleus, celui des déportés et un monument aux morts, d’esplanade des compagnons de la Libération.
En janvier 2010, les locaux désaffectés de l’ancien bowling sont attribués par la ville à une association culturelle sous le nom de Bobine et deviennent une salle de spectacles et de restauration. Le 14 mai 2011, une œuvre monumentale d’Alain Kirili, Résistance, est inaugurée dans le parc en présence de Lionel Jospin et de Catherine Tasca. En 2011, le parc Paul-Mistral a été le point de départ et le point d’arrivée de la 20e étape du Tour de France ainsi que de la 3e étape du Critérium du Dauphiné. En 2012, un parcours identique autour du parc se déroule en tant que prologue du Critérium du Dauphiné.
Quant à la tour Perret, fermée au public depuis 1960, elle reste dans l’attente d’une rénovation.
Arbres et espaces verts du parc
Arbre remarquable du parc
En 2011, le parc Paul-Mistral possède 1 539 arbres avec 96 espèces différentes19. Parmi les espèces les plus nombreuses du parc, figurent 174 platanes, 128 peupliers noirs, 109 épicéas, 92 ifs, 78 merisiers à grappes, 72 bouleaux, 65 séquoïas de Chine, 55 érables plane, 55 tulipiers de Virginie, 54 hêtres, 37 pins sylvestre, 36 pins noir d’Autriche, 35 Cyprès de Lawson, 27 érables sycomore, 16 cèdres de l’Atlas, 15 érables negundo, 14 érables champêtre, 13 ormes champêtre, 12 Ginkgo biloba, 11 Koelreuteria paniculata, et 9 liquidambars.
La superficie du parc recouverte par du gazon est de 70 612 m², par les différents cheminements 63 850 m², par des arbustes 11 534 m², par des plantes vivaces 600 m², et par des massifs 280 m². Le total de ces superficies représente un total de 14,68 hectares. L’extension récente du parc Paul-Mistral représente 13,25 hectares.
Notes et références
- ? Superficie calculée sur Google earth avec les limites du boulevard Jean-Pain, de la rue de Valmy, du boulevard Clemenceau, de la rue Colonel-Driant et incluant la place Paul-Mistral.
- ? Pour sa partie sud, le côté ouest ayant été supprimé par le maire Édouard Rey dans les années 1880.
- ? Le boulevard des Alpes prendra le nom de Jean Pain en 1944.
- ? Archives municipales de Grenoble, cote 2F84.
- ? Les Nouvelles de Grenoble, novembre 2001.
- ? Archives municipales de Grenoble, cote 355W29.
- ? Les Nouvelles de Grenoble, N°55 de novembre 2001.
- ? Vital Chomel, Histoire de Grenoble, page 363.
- ? Souvenirs de la guerre d’Espagne [archive]
- ? Mémoire de l’île, Union de quartier Ile Verte, 2006, page 141.
- ? Selon le livre Grandes et petites histoires des rues du quartier Exposition-Bajatière, page 88.
- ? Archives municipales de Grenoble, cote 533M27.
- ? C’est la construction d’une piste en bois pour les 6 jours cyclistes qui fera changer de dénomination le stade de glace.
- ? Site Grenoble c’est mieux. [archive]
- ? Ivan Boccon-Perroud et Marie Savine, Un musée sans murs.
- ? Archives municipales de Grenoble, cote 1957W44.
- ? http://davidibanez.com/webdoc.php [archive]
- ? http://davidibanez.com/webdoc.php [archive]
- ? Selon données du service des espaces verts de la ville.
Historique du stade des Alpes
Sa livraison, initialement prévue pour septembre 2004, ne devint effective qu’au printemps 2008. Les raisons de ces retards sont multiples, mais on pourra citer la contestation répétée du permis de construire, la révision de l’appel d’offre initial, les recours en justice et les actions d’opposants qui iront jusqu’à l’occupation illégale et permanente d’arbres de novembre 2003 à février 2004. Durant ce laps de temps, ils sont soutenus par les dons de divers organisations et d’une partie de la population, mais ils seront finalement délogés par les forces de l’ordre.
La reconstruction d’un stade est contestée par 4 grands arguments: son emplacement, son orientation, son utilité, son coût. En effet, son orientation parallèle au boulevard Jean Pain, à 90° par rapport à celle de l’ancien stade Charles Berty, ainsi que le besoin de faire accéder les engins de chantier, entraînent la coupe d’environ 200 arbres, dont certains très anciens.
Un autre argument soulevé fut celui de sa localisation, proche de l’hyper centre ville grenoblois. Le stade restait en bordure d’un des principaux espaces verts de la ville et les riverains craignaient les embouteillages et autres nuisances sonores qu’allaient occasionner les manifestations qui s’y dérouleront. Il existait pourtant des emplacements disponibles en périphérie. le site de Saint Martin d’Hères qui fut la solution alternative la plus crédible est ainsi à près de 400m à vol d’oiseau de l’arrêt de tram le plus proche Mayencin Champ Roman et son principal accès se fait par la rocade sud, régulièrement encombrée, tout comme le centre-ville. Il aurait néanmoins fallut aménager une passerelle, ce qu’IKEA a fait partiellement par la suite.
Le litige est allé jusqu’au Conseil d’État qui, par l’arrêt du 17 juillet 2009 vient casser la décision de la Cour d’Appel de Lyon, qui considérait que le Stade et le parking devait faire l’objet d’un permis de construire unique (et non de deux permis distincts). Le Conseil d’État a au contraire affirmé l’absence d’obligation de déposer un permis de construire unique lorsqu’un ensemble immobilier est constitué de deux éléments distincts, si et seulement si chacun de ces éléments a une vocation fonctionnelle autonome et en raison de l’ampleur et de la complexité de chaque opération.
Le stade a été réalisé par l’entreprise Demathieu & Bard. La structure métallique et l’enveloppe vitrée ont été exécutées par l’entreprise Cabrol.
- Le premier match a eu lieu le 15 février 2008 lors du match de la 24e journée du Championnat de France de football de ligue 2, opposant Grenoble à Clermont. Il s’est soldé par une victoire du GF38 par 2 buts à 0, avec des réalisations de Franck Dja Djedje (19′) et de Nassim Akrour (29′) devant 18 828 spectateurs.
- Le premier match international fut une rencontre de rugby à XV qui eu lieu le 22 février 2008 et opposa l’équipe de France à celle d’Angleterre dans le cadre du Tournoi des six nations des moins de 20 ans. Victoire de l’Angleterre 24 à 6 devant environ 20 000 spectateurs.
- Le 26 septembre 2008, la rencontre de rugby à XV opposant le CS Bourgoin-Jallieu au Stade français eut lieu au stade des Alpes devant plus de 17 000 spectateurs. Le Stade français s’est imposé 32 à 25.
- Johnny Hallyday est le premier artiste à s’être produit au Stade des Alpes, le 1er juillet 2009, à l’occasion du passage de sa tournée d’adieux « Tour 66 ». Plus de 26000 spectateurs ont assisté au concert.
Anneau de vitesse de Grenoble
Une prouesse pour l’époque…
Situé dans le parc Paul Mistral, non loin de la Mairie de Grenoble, cet Anneau de Vitesse a été construit en extérieur à l’occasion des Jeux Olympiques d’Hiver de 1968, afin d’accueillir les épreuves de patinage de vitesse sur glace.
Reposant sur une dalle de béton parfaitement rigide, il était recouvert de glace chaque hiver jusque vers la fin des années 80 : le système de réfrigération, aujourd’hui démonté, comportait un réseau de tubes de 108 km de long qui assurait la fabrication de la glace artificielle et une centrale qui alimentait la piste en froid.
Photo : l’Anneau de Vitesse de Grenoble en glace, de nuit.
Tour Perret (Grenoble) http://fr.wikipedia.org
La tour Perret est une tour d’observation située à Grenoble dans le parc Paul-Mistral. Elle est aussi appelée tour d’orientation, non parce que les quatre points cardinaux sont moulés au sommet mais parce qu’une table d’orientation, prévue par le Touring club de France, en fait le tour au niveau 60 m afin de situer les bâtiments de l’Exposition internationale de la houille blanche et du tourisme qui se déroulait à ses pieds sur 20 hectares. Elle permettait en outre aux touristes de situer les montagnes alentours. C’est la première tour en béton armé construite en Europe1.
Construction
Elle a été construite par l’architecte et entrepreneur Auguste Perret en 1924 à l’occasion de la tenue du 21 mai au 25 octobre 1925 de l’exposition internationale de la houille blanche et du tourisme sur la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique, et le tourisme, seconde source d’activité économique dans les Alpes au début du siècle. Durant l’exposition, des projecteurs ont été installés au sommet pour éclairer les bâtiments. Par la suite, une antenne de TSF a été installée au sommet de la tour afin de retransmettre des émissions de radio. La tour est la seule construction restante de cette exposition.
Haute de 95 mètres et de section octogonale, elle repose sur des fondations de 15 mètres constituées de 72 pieux de ciment armé réunis au sommet par une dalle et s’appuyant sur une couche dure de graviers. Le diamètre de la tour est de 8 mètres à la base. C’est la première tour en béton armé du monde. Auguste Perret, à l’aide de Marie Dormoy, critique d’art, est venu à Grenoble pendant 2 ans, faire des conférences et rencontrer les milieux politiques et artistiques modernes, afin de faire apprécier son « ordre du béton armé » ; en références aux ordres antiques. La tour est le produit d’une pensée architecturale et structurelle particulièrement moderne et précise. C’est une structure de béton armé dont les coffrages sont modulaires et répétitifs, et les remplissages préfabriqués sont des remplois qui viennent de l’église du Raincy. Elle a suscité toutes les critiques pendant sa construction, mais c’est une réussite qui a coûté 2 fois moins que les autres édifices de l’Exposition.
Elle offre un panorama unique sur la ville de Grenoble.
Elle a été classée au titre des monuments historiques en 1998. Elle n’est plus accessible à la visite depuis treize ans et un plan de restauration de la structure en béton est à l’étude.